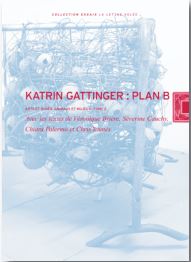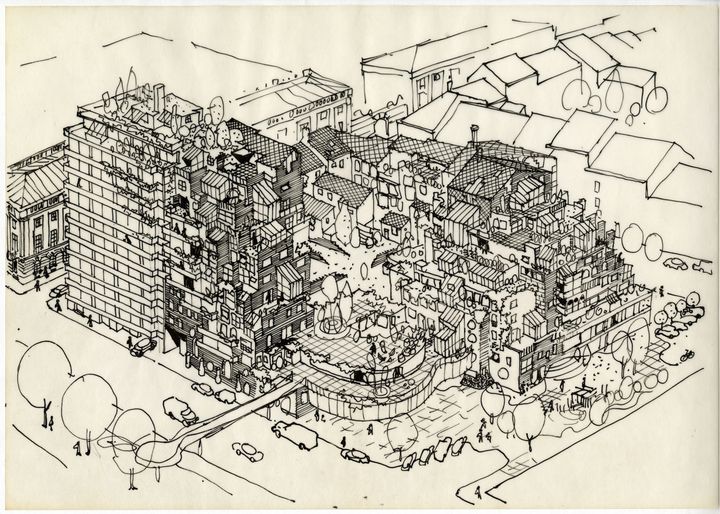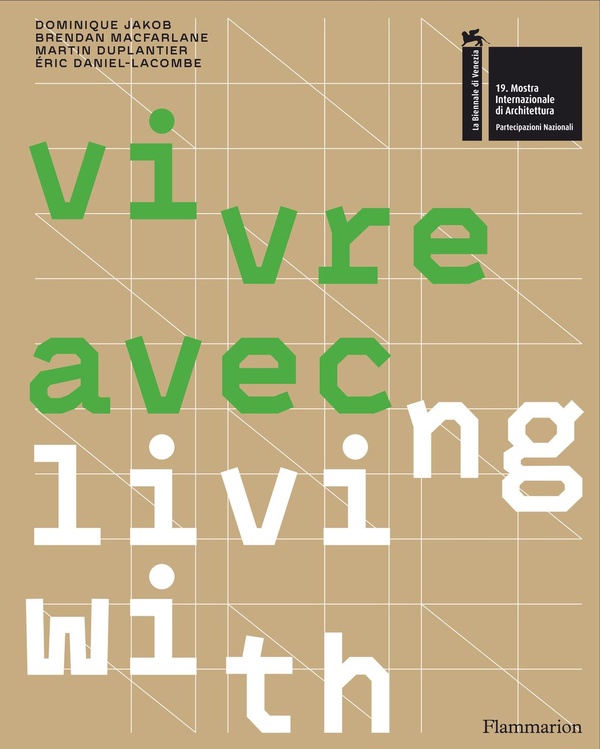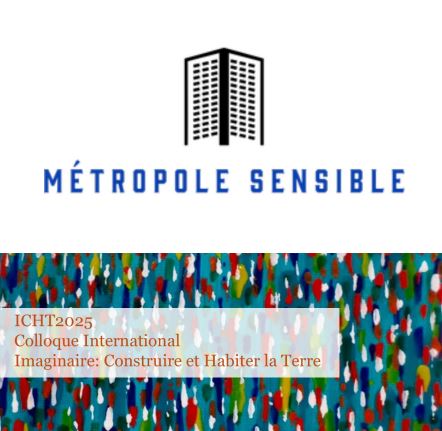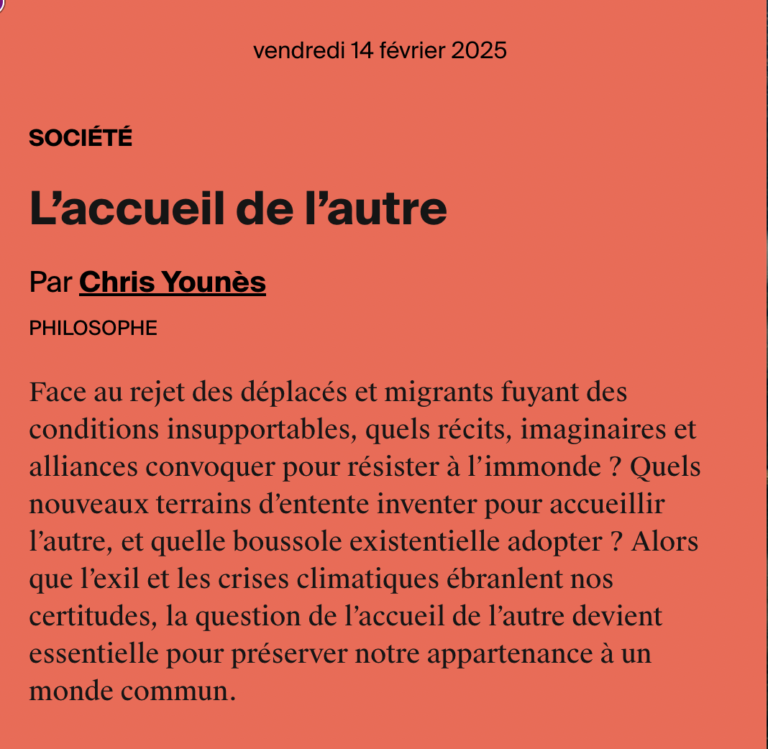La nécropole contemporaine, forme urbaine liée au développement des grandes villes, révèle un rapport particulier qu’a notre société avec la mort, ainsi qu’une manière de concevoir la ville et l’architecture qui la compose. Cette recherche vise à mettre en valeur la naissance et l’évolution de cette forme urbaine depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, en étudiant les facteurs et les enjeux de son développement. Le corpus est principalement constitué de réalisations implantées dans Paris et sa banlieue proche. Ce choix est dû à la place majeure qu’occupe la France, et plus significativement Paris, en Europe au début du XIXe siècle. En effet, les origines de la nécropole moderne trouvent leurs racines dans le contexte d’après Révolution Française, à Paris. Avec les Lumières, l’espace funéraire subit un changement radical dans son organisation et sa forme. Le cimetière d’Ancien Régime, insalubre et bruyant, dans lequel se mélange l’espace des morts et des vivants au cœur de la ville, va laisser place à un espace périurbain, uniquement dédié aux morts. Mais cette mutation n’est ni rapide ni évidente. Les réflexions des Lumières, riches de projets d’architectes et de penseurs, insufflent avant tout un esprit de remise en cause. L’espace funéraire devient progressivement un sujet d’architecture et d’urbanisme. Pour autant, les nouvelles dispositions sont moins évidentes à trouver et à se mettre en place. La lutte de pouvoir entre l’Eglise, qui perd le contrôle de cet espace, et l’Administration qui doit s’en investir, ne contribue pas à faciliter la réalisation de nouveaux projets. Il faut attendre la début du XIXe siècle pour voir la naissance et la mise en place du cimetière moderne. C’est une période complexe dans laquelle nous pouvons distinguer deux étapes. La première étape marque la création des premières nécropoles modernes parisiennes, symbole d’un espace funéraire rêvé. Les textes qui légifèrent cet espace, les réflexions des architectes, des religieux et des administratifs aboutissent à la naissance de la première forme funéraire moderne. Dans l’imaginaire des artistes, le nouveau cimetière est un lieu romantique, parce qu’il est à l’écart de l’agitation urbaine. Mais dans la réalité, ce n’est pas le coin de nature espéré. Façonnée par les autorités politiques sans considération pour les pratiques populaires, cette nouvelle forme spatiale trouve difficilement sa place dans la ville et dans la société. La deuxième étape se met en place sur les désillusions laissées par la précédente. En effet, les premières réalisations ne sont pas à la hauteur des idéaux qui les ont vu naître et s’avèrent vite inadaptées à la croissance urbaine. Cette seconde période est constituée par l’usage des cimetières périphériques multiples dans un contexte d’urgence. En parallèle, la réflexion s’oriente vers la création de nécropole surdimensionnée très éloignée de la ville. Ce paysage funéraire évolue au cours du XXe siècle, à la fois dans la perception du public et dans l’attitude de ces concepteurs. Alors que les nécropoles parisiennes trouvent une stabilité de fonctionnement, les difficultés se déplacent vers les cimetières de la banlieue Seine. Dans ce contexte de densité étendue, se développe la solution des cimetières intercommunaux, ultime mutation de la nécropole moderne. L’architecte Robert Auzelle y joue un rôle majeur. Il nous offre à la fois une théorie de l’espace funéraire en même que la preuve de son application possible au travers de sa pratique. Son travail sur l’intégration urbaine de la nécropole est traité comme un point essentiel de son intégration sociale. Enfin, l’usage d’un vocabulaire architectural approprié à l’espace funéraire ainsi qu’une synthèse des grands modèles lui permettent de proposer une forme composée avec harmonie.
< Retour
Les Nécropoles de Paris et sa banlieue : Formation et transformation d’un espace urbain
Annabelle Iszatt
dir. Jacque LUCAN
dir. Jacque LUCAN
EPFL
2012

Filtrer

Par catégorie
Par année
Par auteur·rice
Sélectionner dans la liste

La distribution collective comme support d’une identité de l’habitat urbain fondé sur le commun
Bastien Viguier
coord. Valérie Lebois, Emmanuel Marx, Mireille Diestchy, Pierre Servain
coord. Valérie Lebois, Emmanuel Marx, Mireille Diestchy, Pierre Servain

Métamorphoses des représentations et des manières de faire monde avec les animaux
Chris Younès
dir. Sandrine Israël-Jost et Katrin Gattinger
dir. Sandrine Israël-Jost et Katrin Gattinger