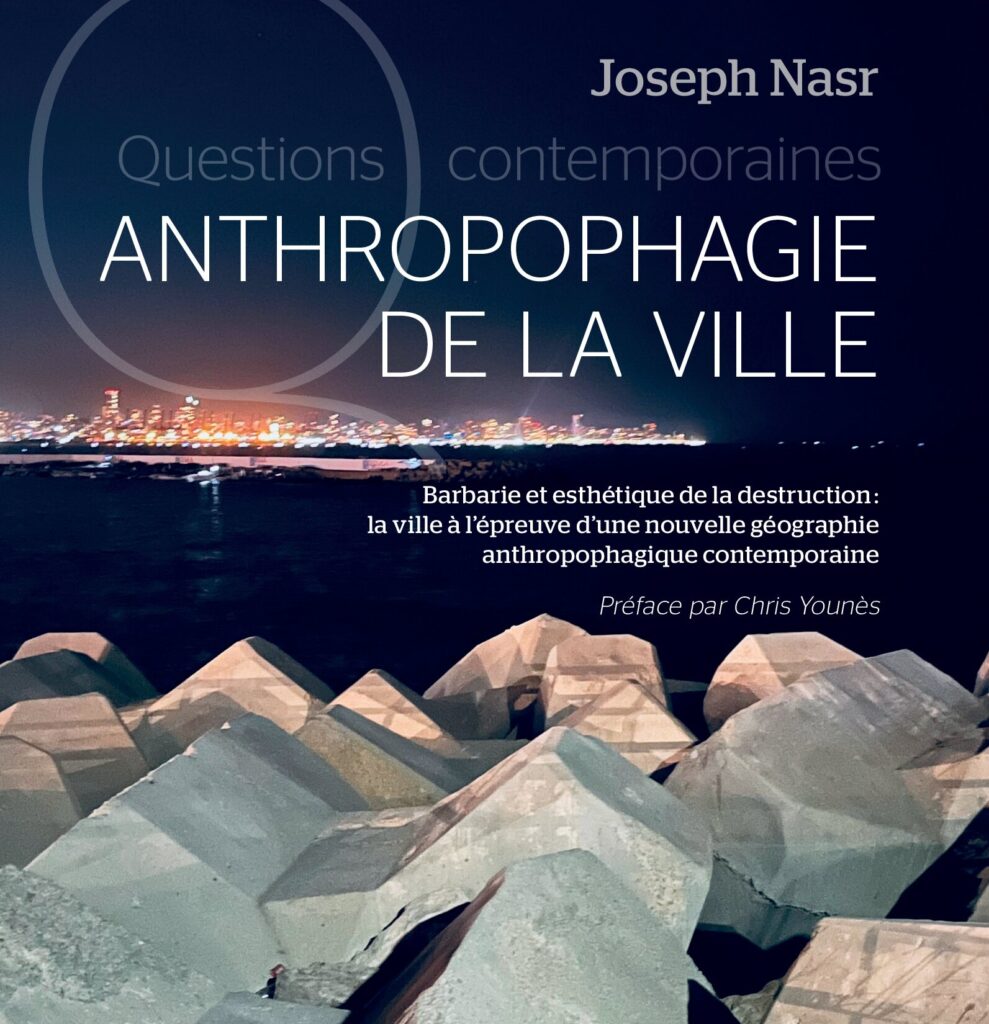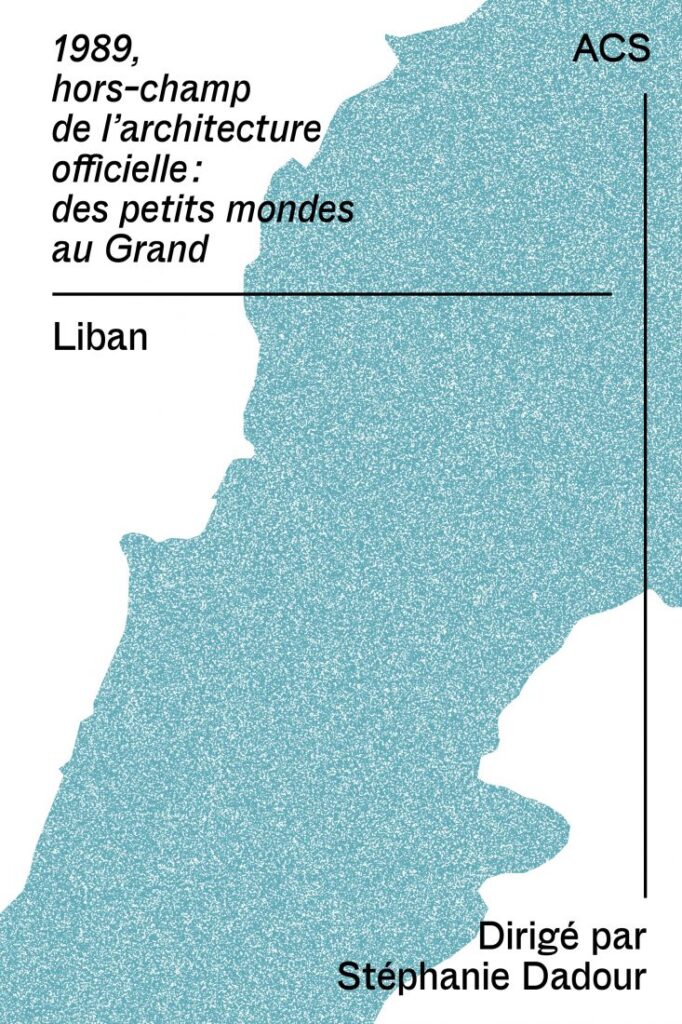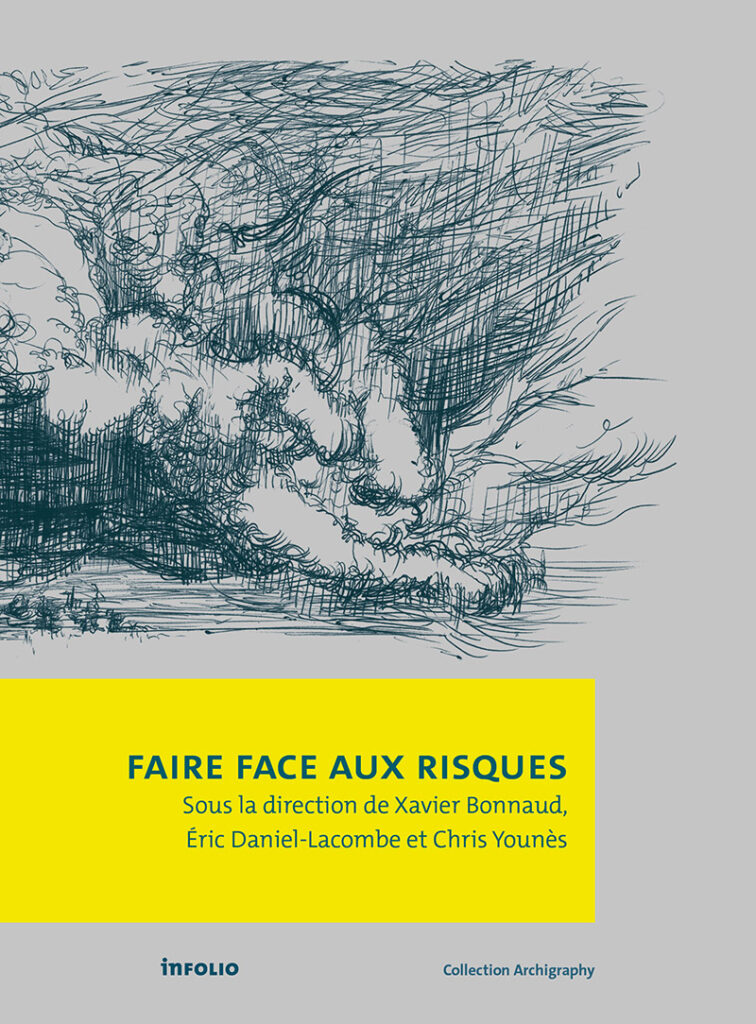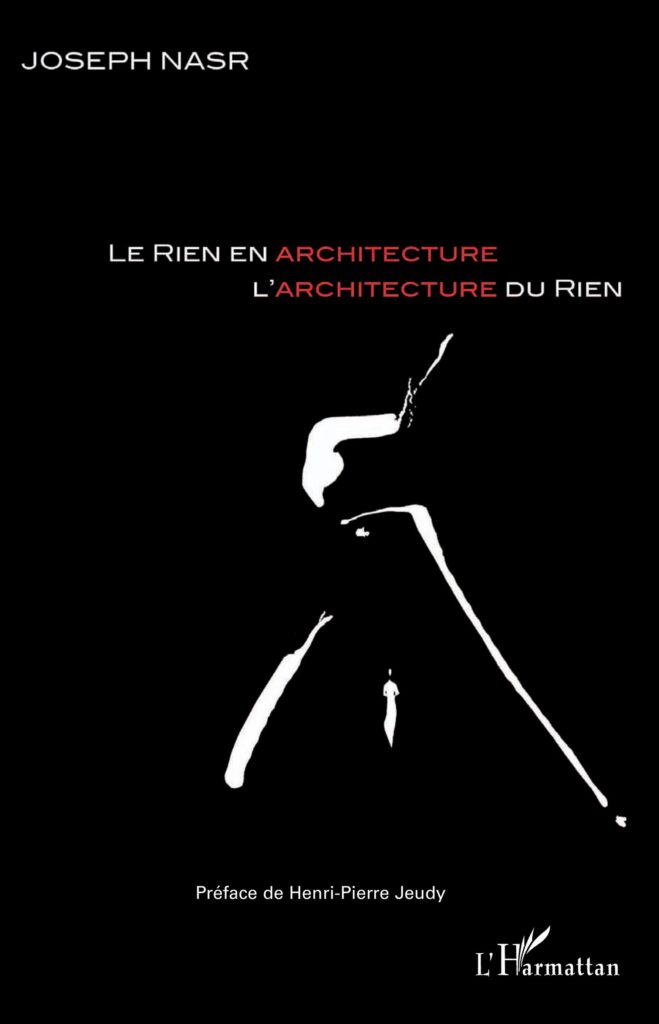Qu’est-ce que la Méditerranée et combien de Méditerranées y a-t-il ? Depuis les travaux du pionnier des études méditerranéennes Fernand Braudel, les multiples visages de l’espace méditerranéen ont maintes fois été peints. Considérée par ce dernier comme une « série de péninsules » et un « complexe de mers » qui s’étend entre le désert au Sud et l’Europe au Nord et qui tient une frontière liquide avec l’Atlantique, la Méditerranée forme, dans sa diversité, une unité à la fois physique et humaine.
Bien que le terme de “connectivité” n’y apparaisse pas, il est question de la construction d’un « espace-mouvement », créé à travers des réseaux de routes, d’échanges et de transferts notamment entre les villes, les côtes et les îles méditerranéennes toujours renouvelés.
Selon des modalités spatiales comparables, les historiens Peregrine Horden et Nicholas Purcell introduisent la notion de “connectivité” dans le domaine des études méditerranéennes afin de promouvoir une image de la Méditerranée en tant que réseau de communications. Issu de la théorie mathématique des graphes, le concept de connectivité se trouve donc ici appliqué à la géo-histoire dans l’intention de décrire « l’environnement méditerranéen et […] la manière dont l’humanité interagit avec lui » dans une perspective historique.
Cette vision de réseau de communication implique donc le lieu, le temps et l’humain qui par les circulations et les migrations trace des frontières toujours nouvelles et multiples – réelles et mentales. Car, outre le système de routes concrètes, la notion de connectivité désigne aussi le mode abstrait de circulation de savoir et d’échange culturel à l’intérieur du bassin méditerranéen.
De ce point de vue, il s’agit d’une figure de pensée exprimant également les concepts de transfert et de médiation culturels basés sur la circulation d’objets, de pratiques, d’héritages, de discours, d’informations, de textes et d’images entre les différentes cultures du pourtour méditerranéen.
Ce qui est en jeu c’est l’écriture d’une « histoire de nœuds et de lignes droites ». « Mer de communication », la Méditerranée est également « une mer de conflits » qui, depuis l’aube des temps, se caractérise par des affrontements de peuples et de communautés riverains.
Cela devient évident de manière accentuée au moment du grand essor des nationalismes et impérialismes européens quand la Méditerranée devient un mythe consubstantiel à la création de différentes identités nationales.
Ainsi, le terme de connectivité ne revêt pas seulement l’idée de communication mais aussi celle de conflit entre les mémoires et entre les imaginaires de différentes nations. Espace « bicéphale » par excellence, la Méditerranée, à la fois fragmentée et interconnectée, est formée par des relations ainsi que des lignes de forces qui créent une tension constante entre différents centre(s) et périphérie(s).
Afin d’envisager une “histoire croisée” de la Méditerranée, l’objectif principal est de développer des approches théoriques et d’entreprendre des études de cas qui permettent de penser le concept de connectivité de l’espace méditerranéen dans les diverses disciplines et, ce faisant, d’instaurer un dialogue inter- et transdisciplinaire convoquant aussi bien l’histoire, l’économie, le droit, la géographie, les lettres, les arts, les sciences de communication et de média et la philosophie.