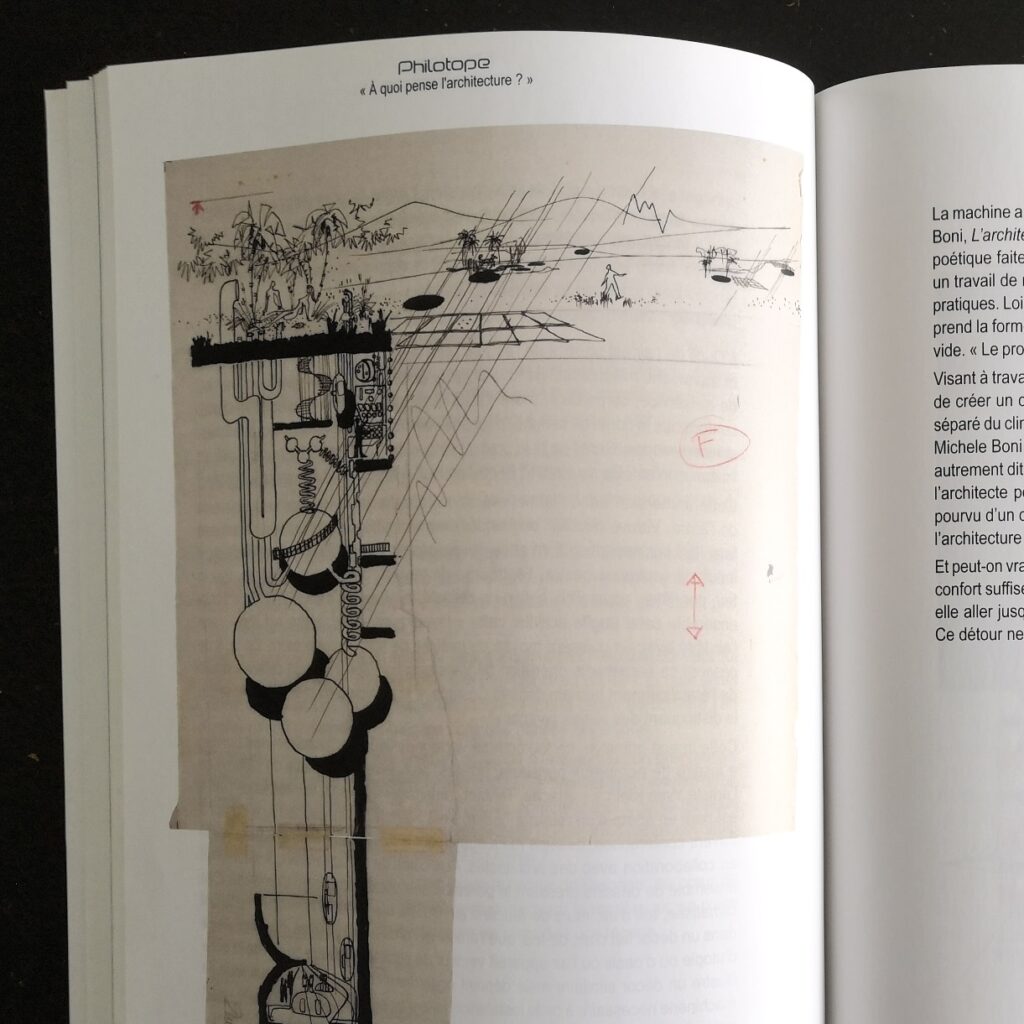PRÉSENTATION
Ses recherches portent sur les modes d’existence de l’air en architecture et interrogent les instruments d’une respiration devenue mécanique. Puisant dans ses expériences de terrains en tant qu’architecte, elle raconte et étudie le traitement de l’air, considéré non plus comme solution mais comme construction sociotechnique qui mérite d’être questionnée par les objets, les gestes, manipulations et bricolages qui en sont faits quotidiennement en architecture.
THÈSE EN COURS
Dans les entrailles de l’architecture, dans les locaux techniques dédiés au traitement de l’air, des personnes veillent sur des machines qui elles-mêmes s’activent pour maintenir nos conditions de respiration. Là, dans un bourdonnement incessant, se mêlent, s’entremêlent, les poussières et particules de nos intérieurs, celles des matériaux qui les composent, celles rejetées par nos corps, ou encore les pollens et autres insectes dont les corps aspirés s’agglutinent sur des filtres. Des atmosphères qui interrogent. Comment est appréhendée au quotidien la complexité de ces environnements techniques ? Pour quelles conditions de travail ? Pour quels effets sur l’air ?
Pour en saisir les enjeux, ce travail déplie des entretiens et observations de terrain de lire à la lumière de ce que Maria Puig de la Bellacasa nomme Matters of care (Puig de la Bellacasa 2017). Parce que s’intéresser aux dispositifs de traitement de l’air amène à déplacer la question du soin des machines vers celui de la matière et soulève de nouvelles questions. Qu’est-ce que le soin de l’air en architecture dès lors qu’il est délégué aux machines ? Autrement dit, dans quelle mesure, prendre au sérieux le soin de l’air en architecture peut nous engager vers une compréhension renouvelée des dispositifs sociotechniques mis en place pour le contrôler ? Derrière une attention à nos systèmes de ventilation mécanisée, derrière le soin qui leur est porté, se niche des enjeux de santé, se jouent nos conditions de respiration en commun dans des espaces intérieurs qui sont loin d’être inertes.